L’homme qui a tué Dieu
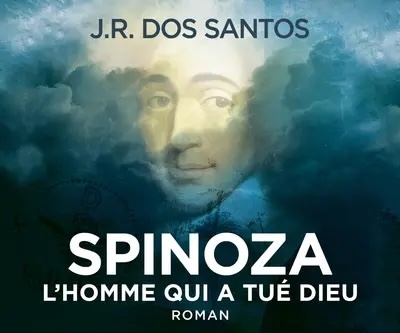
Ce titre provocateur est celui d’un roman historique écrit par Dos Santos sur Spinoza et sa philosophie. La « mort de Dieu » était l’un des thèmes de Nietzsche au début du 20ème siècle, or Nietzsche se sentait proche du philosophe du 17ème siècle. En tant que chrétiens, nous ne devrions pas craindre ce genre d’affirmation. En effet, la « mort de Dieu » peut être une bonne chose si le « Dieu » en question n’est pas le Dieu de Jésus-Christ, Dieu le Père, Créateur du ciel et de la terre, mais un dieu qui n’en a jamais été un. Toutefois, il y a tout lieu de penser, comme nous allons le voir, que le Dieu personnel de la Bible a été rejeté par Spinoza.
Spinoza, un philosophe pas comme les autres
Ce qui fait de Spinoza un philosophe exceptionnel, c’est la rigueur et la radicalité de son raisonnement. Aucun philosophe n’a réussi à construire un édifice aussi solide et imprenable que le sien. Son influence a été beaucoup plus grande que ce que l’on pourrait penser. On peut le considérer comme un des fondateurs de la pensée moderne, le plus radical des philosophes des Lumières.
D’autre part, on peut comparer la lecture de Spinoza à un parcours initiatique. En effet il a vécu ce qu’il a cherché à démontrer et il nous entraine à sa suite avec une force de conviction inégalée. Dos Santos a cherché justement à montrer l’adéquation entre la vie et le message du personnage en cherchant à le faire vivre dans son contexte historique.
Maintenant la question qui nous préoccupe concerne la validité de la philosophie de Spinoza en ce qui concerne Dieu. On pourrait poser la question de la manière suivante : Spinoza était-il un athée ? Ou d’une autre manière : à quel Dieu Spinoza croyait-il ?
Ce qu’il y a de sûr, c’est que Spinoza considérait le judaïsme et le christianisme comme des superstitions et la Bible comme une invention humaine. Avancer de telles affirmations à son époque pouvait coûter très cher. Du reste Descartes, qui avait vécu lui aussi dans les Provinces Unies (actuels Pays-Bas) une génération avant, n’avait pas osé franchir ce pas, même si sa philosophie poussée à l’extrême menait à cette conclusion. On ne cherchera pas ici à relever le défi lancé par la philosophie des Lumières à la Bible en tant que révélation, aux miracles… C.S. Lewis a déjà répondu à ces questions de manière brillante et le grand mathématicien John Lennox également de nos jours. Revenons à Spinoza.
L’importance d’un postulat
Dans son livre, Dos Santos prête à Spinoza un dialogue avec la sœur d’un de ses proches amis, De Vries. La question est posée par Trijntje, la sœur de De Vries à Spinoza : le diable existe-t-il ? Réponse du philosophe : non ! Le bien et le mal n’existent que dans nos têtes, pas dans la nature. Trijntie, piquée au vif, lui sert un raisonnement pour démontrer l’existence du diable : « Tout le monde sait que Dieu, dans son infinie miséricorde, est le bien suprême. Etant donné que le mal existe et que par définition, il ne peut être responsable du mal puisqu’il est le bien suprême, il doit y avoir, par déduction logique, une autre entité responsable du mal, n’est-ce-pas ? Et quelle est cette entité ? Le diable, bien sûr… » Trijntie exige une réponse de la part de Spinoza qui lui répond en substance : « votre raisonnement est juste. C’est votre postulat qui est faux. » Et de lui expliquer que le postulat à partir duquel tout déduire logiquement consiste à dire que Dieu est infini, et non pas à dire que Dieu est bon. A partir de là, explique-t-il « si Dieu est infini alors Dieu est tout, et si le bien et le mal font partie de tout, alors Dieu inclut le bien et le mal…. Donc le diable n’existe pas. La sœur de De Vries s’insurge : mais alors le mal viendrait aussi de Dieu ? Et Spinoza de lui expliquer alors que le bien et le mal n’existent pas en tant que tels…
Ce dont la sœur de De Vries ne s’aperçoit pas, c’est que la définition de Dieu donnée par Spinoza n’est pas plus légitime (sinon moins…) que celle qu’elle-même a donnée ! Si son postulat pouvait être faux, celui de Spinoza pouvait l’être tout autan!
Définir Dieu à partir de quoi ?
Pour mémoire, le catéchisme de Westminster donne du Dieu de la Bible la définition suivante :
« Dieu est un Esprit, en lui-même et par lui-même, infini dans son être, sa gloire, sa béatitude et sa perfection ; tout-suffisant, éternel, immuable, incompréhensible, partout présent, tout-puissant, connaissant toutes choses, très sage, très saint, très juste, très miséricordieux et gracieux, tolérant et abondant en bonté et en vérité. » Cette définition part essentiellement des textes bibliques dont elle fait la synthèse.
Or elle explique que Dieu est « infini » sans pour autant tout englober. Elle montre aussi que l’infinité n’est qu’un attribut parmi d’autres de Dieu. Dieu n’est pas seulement infini, mais aussi d’autres choses. Et l’infini concerne son être, sa gloire, sa béatitude et sa perfection, mais ne concerne pas la « substance divine » : il remplit tout de sa présence ne signifie pas qu’il est tout. On parle par exemple de « présence » pour un acteur. Quand ce personnage est sur scène, il remplit l’atmosphère, il prend toute la place, mais il n’est pas pour autant la chaise ou le rideau de la scène. C’est sa présence qui remplit la scène et non sa substance. A l’inverse on dira de quelqu’un d’autre qu’il passe inaperçu ou qu’il est « transparent ».
Nous sommes partis ici du texte biblique tel que compris par le catéchisme de Westminster. Or Spinoza rejetait ouvertement le texte biblique comme trop humain. En bref ce sont les hommes qui auraient inventé Dieu, qui se serait créé un Dieu à leur image et non Dieu qui aurait créé l’homme à son image. Soit j’interprète le texte biblique à la lumière de mon expérience et de mes déceptions vis-à-vis de la religion, soit je remets en question la manière dont les religieux lisent la Bible à la lumière de la Bible et dans la prière. Je cherche à connaître le Dieu vivant et vrai qu’elle me décrit. Or la Synagogue et l’Eglise de l’époque ne reflétaient pas la vie de Dieu telle que décrite dans la Bible et condamnaient, excluaient ou excommuniaient ceux qui posaient les questions qui fâchent.
La force d’une définition
Récemment, à l’occasion de la fermeture de la chaîne de télévision C8, un journaliste belge estimait Cyril Hanouna était inécoutable autant sur la forme que sur le fond parce qu’il ne transmettait pas des informations fiables et n’était respectueux dans sa manière de parler. Or Pascal Praud, le journaliste d’Europe 1 voulait remettre en question ce jugement trop sévère à son goût. En guise de préambule, Pascal, manifestement ami et proche de Cyril, dit à son adversaire : « le seul talent, je dis bien le seul talent que l’on demande à un journaliste de média, c’est celui de plaire ! » Le journaliste belge acquiesça sans réfléchir ! Il avait déjà perdu la partie ! En effet, Cyril Hanouna étant très aimé d’un public nombreux devenait ainsi inattaquable. Le Belge aurait dû rétorquer : « je ne suis pas d’accord avec votre critère ce qu’est un bon journaliste de média, ce n’est pas le seul talent qu’on lui demande ! On lui demande de plaire, certes, mais TOUT EN ETANT fiable dans l’information qu’il transmet ou commente et respectable dans le ton qu’il utilise. » Le piège était de donner une définition fautive ou du moins PARTIELLE de ce qu’un bon journaliste est censé être.
Limites des définitions et postulats du spinozisme
Revenons à notre sujet. Dans son œuvre posthume, Ethica, Spinoza donne une définition de Dieu : « Par Dieu, j’entends un être absolument infini, c’est-à-dire une substance constituée par une infinité d’attributs, chacun d’eux exprimant une essence éternelle et infinie. » Chez Spinoza la « substance » peut être comprise comme l’être même. Notre question est maintenant la suivante : est-ce que cette définition correspond à celle du Dieu de la Bible ?
Oui, Dieu est un être infini. Mais il n’est pas seulement un être absolument infini ! Le mot « absolument » fait de cet aspect de la nature de Dieu la seule caractéristique qui permet de le définir. Dieu est décrit comme « infiniment grand ». Par exemple Salomon dit « Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir… » (2 Chroniques 6 :18). Mais elle ne dit pas que Dieu est « tout ». Lorsque Paul parle du moment de la victoire finale où Dieu aura tout soumis à son Fils et que celui-ci sera soumis au Père (1 Corinthiens 15 :28), il dit que « Dieu sera tout en tous ». Ce serait probablement l’affirmation biblique la plus proche du spinozisme que l’on puisse trouver. Mais la logique du « tout c’est tout » est mise à mal dans 1 Corinthiens 15 :27, qui montre que cette logique souffre une exception. D’autre part « tout en tous » signifie une souveraineté totale sur tout être humain et non un panthéisme absolu.
D’autre part, selon Spinoza cette substance divine est unique : il s’agit d’un Dieu « unipersonnel ». Or, du point de vue biblique, la trinité n’est pas envisageable selon cette définition. Les citations de l’Ethique ci-dessous nous le montrent :
« Dans la Nature, il ne peut exister deux ou plusieurs substances de même nature, c’est-à-dire de même attribut » (Ethique I Proposition 5)
« Si une substance pouvait être produite par autre chose, la connaissance de cette substance dépendrait de la connaissance de sa cause et par suite, ce ne serait pas une substance. » (Ethique I Proposition 5) En effet la « définition 3 » dit : « par substance, j’entends ce qui est en soi et est conçu par soi, c’est-à-dire ce don le concept n’exige pas le concept d’une autre chose, à partir duquel il devrait être formé. »
On arrive à la proposition 14, corollaire 1 « Dans la nature, il n’existe qu’une seule substance et qu’elle est absolument infinie… »
On rétorque parfois aux chrétiens que le concept de la trinité n’est pas logique, pourtant il peut trouver un équivalent logique en mécanique quantique (inégalité d’Heisenberg et niveaux d’énergie). C’est plutôt notre logique qui ne part pas des bonnes prémisses.
La bonne voie
Maintenant posons-nous une autre question : quel serait la meilleure « définition » de Dieu sur laquelle s’appuyer ?
Voici une réponse magistrale de Michael Reeves dans son livre « The Good God » :
« Il y a deux manières différentes de penser à Dieu, ou deux approches distinctes. La première approche ressemble à un sentier de chèvres glissant, situé au sommet d’une falaise. C’est le chemin qui consiste à se représenter Dieu avec la seule puissance de notre raison. Je regarde le monde qui est autour de moi et je sens que tout cela doit bien venir de quelque part. Quelqu’un ou quelque chose a été la cause de l’existence de ce monde, et j’appellerai ce quelqu’un « Dieu ». Dieu est donc celui qui amène tout ce qui n’est pas lui-même à l’existence, et qui n’a pas lui-même reçu son existence d’un autre être. Il est la « cause incausée ». C’est ce qu’il est. Dieu est, essentiellement, le Créateur, Celui qui a la charge de toutes choses.
Tout cela semble très raisonnable et imparable, mais si je commence avec ce point de vue de base sur Dieu, je verrai chaque centimètre carré de mon christianisme recouvert et détruit par la pensée la plus toxique que l’on puisse imaginer. En effet, si l’identité même de Dieu est d’être le Créateur, le Gouverneur, alors il a besoin d’une création sur laquelle dominer pour être ce qu’il est par définition. Quelle que soit son immense puissance cosmique, ce Dieu fait vraiment pitié : il a besoin de nous ! Et pourtant vous auriez de la difficulté à éprouver cette pitié pour lui, sachant ce que ce Dieu est.
Durant l’après-guerre, le théologien suisse Karl Barth en a fait la démonstration avec vigueur :
« Peut-être vous rappelez-vous comment Hitler, lorsqu’il parlait de Dieu, avait l’habitude de l’appeler le « Tout-Puissant ». Mais ce n’est pas le « Tout-Puissant » qui est Dieu ; nous ne pouvons pas comprendre qui est Dieu à partir du point de vue d’un concept suprême de puissance. Et l’homme qui appelle Dieu « le Tout-Puissant » est mauvais, de même que la « puissance » en elle-même est mauvaise. Le « Puissant » signifie le Chaos, le Mal, le Diable. Nous ne pouvions pas mieux définir le Diable qu’en essayant de concevoir cette idée d’un pouvoir autocratique, libre et souverain. »
Maintenant, notons que Barth ne niait absolument pas que Dieu fut Tout-Puissant ; mais il voulait montrer le plus clairement possible que la puissance à l’état pur n’est pas ce que Dieu est.
L’autre manière de penser à Dieu est un chemin éclairé et même pavé : c’est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C’est en fait, Le Chemin. C’est une voie qui finit de manière heureuse dans un endroit bien différent, avec un Dieu tout à fait différent ! Comment ? Eh bien, juste le fait que Jésus soit « le Fils » nous a déjà tout dit. Être le Fils signifie qu’il a un Père. Le Dieu qu’il révèle, est avant tout et surtout, un Père. « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. (Jean 14 :6) Voilà ce que Dieu a révélé sur son être même : non pas avant tout et surtout le Créateur ou le Grand Chef, mais le Père.
Peut-être que la meilleure manière d’apprécier cette révélation est de se poser la question de savoir ce que Dieu faisait avant la création. Maintenant pour celui qui suit le « sentier de chèvre », cette question est absurde et il est impossible d’y répondre. Leurs théologiens les plus prompts à faire de l’humour ont répondu à cette question en usant de l’échappatoire suivant : « Qu’est-ce que Dieu faisait avant la création ? Il préparait l’enfer pour ceux qui auraient assez de culot pour poser de telles questions ! » Mais sur la voie éclairée par Jésus-Christ, cette question trouve facilement réponse. Jésus nous dit explicitement dans Jean 17 :24 « Père, dit-il, tu m’as aimé dès avant la fondation du monde. » Et c’est là le Dieu révélé par Jésus-Christ. Avant même qu’il ait créé quoi que ce soit, avant même de régner sur le monde, avant toutes choses, ce Dieu était un Père aimant son Fils.
Une philosophie décapante
Spinoza nous rend un immense service : même si sa définition de Dieu est des plus dangereuses et mène par ses raisonnements sans faille à un panthéisme très éloigné de l’évangile, il relève avec force à quel point Dieu est infiniment grand. Il détruit les concepts païens des dieux grecs à dimension trop humaine de manière irrémédiable. Mais, et c’est là tout le danger, il nous rapproche du bouddhisme, du nirvana. Il nous décrit un Dieu immanent, mais pas transcendant.
Le grand « Je suis »
Sa conception nous rapproche de la révélation faite à Moïse quand ce dernier demandait à Dieu : si les Israélites me demandent quel est ton nom, que devrais-je leur répondre ? Dieu lui dit de répondre au peuple : « Celui qui s’appelle « JE SUIS » m’a envoyé vers vous. » Spinoza a bien retenu le « SUIS », mais il a oublié le « JE ». Dieu parle à Moïse en commençant par « JE ». Dieu est une personne, il nous apprend ce qui est bien et mal, il nous éduque comme un père éduque son enfant, nous avons des comptes à lui rendre et nous lui sommes reconnaissants pour la vie.
Faire un choix
Nous avons finalement le choix entre un « salut par la connaissance » (c’est ainsi que Jean Brun résume la pensée de Spinoza), ou un salut par Jésus-Christ.
« Ne vous confiez pas aux nobles, à un être humain, à qui n’appartient pas le salut. Son souffle s’en va, il retourne à sa poussière et ce même jour ses intentions périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l’Eternel, son Dieu ! » (Psaume 146)
Un choix entre le Dieu des philosophes ou le Dieu de Jésus-Christ.
 Auteur: Co-fondateur et directeur d’étude de l’IFIM, Institut de formation International de Marseille, Jean-Hugues Jéquier a particulièrement à coeur le monde musulman et la formation de leaders chrétiens équipés dans la Parole et dans l’Esprit. Il est marié et père de 3 enfants.
Auteur: Co-fondateur et directeur d’étude de l’IFIM, Institut de formation International de Marseille, Jean-Hugues Jéquier a particulièrement à coeur le monde musulman et la formation de leaders chrétiens équipés dans la Parole et dans l’Esprit. Il est marié et père de 3 enfants.







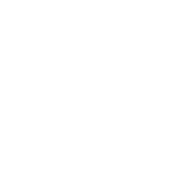


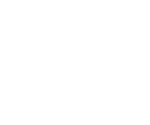
0 Comments